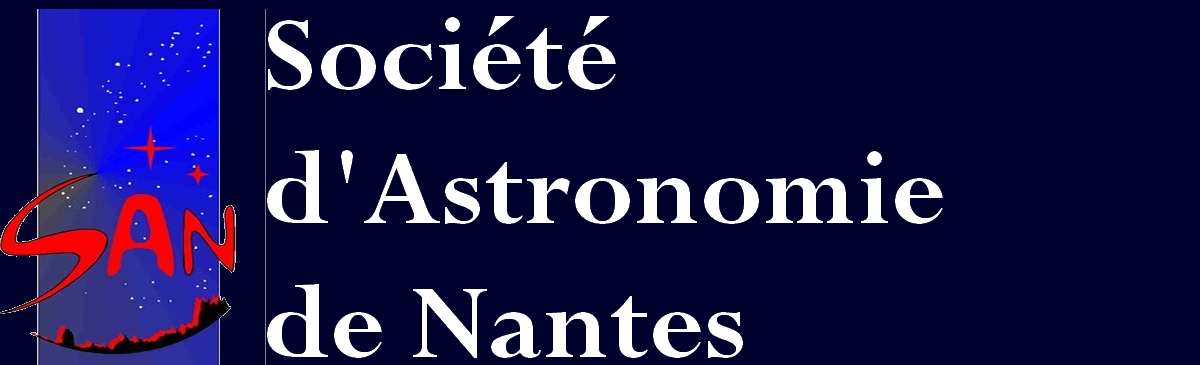Des adhérents de la SAN ont produit des fascicules dont beaucoup datent des années 90.
Nous proposons ici une sélection de ces fascicules qui constituent un patrimoine exceptionnel, en particulier dans les thématiques d'histoire des sciences ou d'astronomie de position dont on trouve peu d'équivalent ailleurs. Ces fascicules méritent toujours d'être lus, même si parfois certaines connaissances (comme la théorie de la formation de la Lune) ou techniques (passage de l'argentique au numérique) ont pu évoluer depuis.
Ils sont classifiés selon différentes thématiques :
- Astrophysique et cosmologie
- Calculs astronomiques et astronomie de position
- Histoire des sciences
- Instrumentation et observations
- Philosophie
- Planétologie
Dans un contexte de diffusion électronique, chaque auteur conserve ses droits intellectuels, notamment le fait de devoir être correctement cité et reconnu comme l'auteur d'un document. La licence qui s'applique par défaut, sauf accord explicite de l'auteur pour une licence moins restrictive, est CC BY-NC-ND 4.0
Pour toute question ou demande sur ces fascicules passer par le contact en bas de page.
Voir ou télécharger les fascicules de la SAN :
Les fascicules sont proposés :
- En visualisation directement dans le navigateur (cliquer sur le bouton vert)
- En téléchargement en format A4 traditionnel (cliquer sur le bouton bleu)
- En téléchargement en format epub pour liseuses (pour l'instant seuls quelques fascicules sont proposés dans ce format, nous contacter pour d'autres besoins).
- En bas de page en format A5 pour impression sous forme de livret (utiliser une impression en recto-verso).
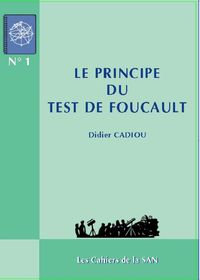
2.26 Mo Thème : instrumentation
Didier Cadiou explique dans ce fascicule comment contrôler soi-même la qualité optique d'un miroir de télescope. Léon Foucault, autodidacte de génie, a inventé une méthode qui, grâce à un appareil très simple, permet de mesurer et de contrôler la surface des miroirs de télescope avec une extrême précision : les défauts du verre, plus petit que la longueur d'onde de la lumière, nous apparaissent soudain comme des précipices et des montagnes ! Sont rappellé dans ce fascicule les notions d'optique instrumentales de base d'une manière simple et la méthode de Foucault est expliquée pas à pas.
📥 01-foucault-test.pdf🔍 01-foucault-test.pdf

2.8 Mo Thème : histoire des sciences
Les 'Principes mathématiques de la philosophie naturelle' est l'oeuvre majeure d'Isaac Newton et l'un des plus importants livres scientifiques jamais publié qui fonde la physique classique. Christian Scotta en a produit l'une des rares traductions en français en 1991. Disponible à la Bibliothèqie Nationale de France (BNF) cote: 4-R-22267 et à la médiathèque de la SAN : cote HI009. Ce fascicule propose une synthèse accessible de cette oeuvre dans laquelle Newton développe une vision mathématisée de la nature. Le texte explore les concepts fondamentaux de la physique newtonienne, incluant l'espace et le temps absolus, ainsi que les lois du mouvement et la gravitation universelle. Une partie importante est consacrée à l'application de ces lois, notamment l'analyse des orbites elliptiques (lois de Kepler), les calculs de masse et densité des corps célestes, et l'explication des marées océaniques et de la précession des équinoxes. Le document expose également une critique approfondie des théories de Descartes sur les tourbillons, affirmant la supériorité du modèle newtonien basé sur l'action à distance.
📥 02-Les-principes-mathematiques-de-la-philosophie-naturelle.pdf🔍 02-Les-principes-mathematiques-de-la-philosophie-naturelle.pdf
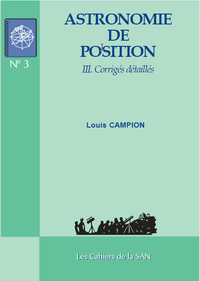
36.83 Mo Thème : calculs
Ce fasicule est le complément des cours de calculs astronomiques proposés dans les fascicules 9 et 37. Il reprend tous les calculs proposés et en donne le résultat avec les détails de calculs.
📥 03-astronomie-de-position-III.pdf🔍 03-astronomie-de-position-III.pdf
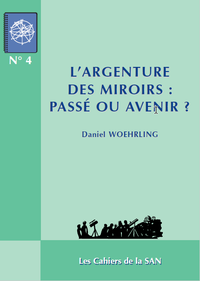
557.83 ko Thème : intrumentation
Ce fascicule explore l'argenture des miroirs de télescopes, une technique ancienne, remise à l'honneur à une certaine époque à la SAN en raison de son coût avantageux face à l'aluminure. Après avoir rappelé les bases historiques et chimique de l'argenture Daniel Woehrling évoque deux procèdés ; l'artisanal délicat et peu fiable et l'industriel, simple, efficace et bon marché. Daniel Woehrling défend l'intérêt de l'argenture face aux idées reçue sur la superiorité de l'aluminure. il soutient que l'argenture bien que plus fragile est facile à renouveler et plus accessible aux amateurs. Il suggère la possibilité d'utiliser des traitements protecteurs pour en améliorer la durabilité. En conclusion il appelle à reconsidérer l'argenture l'argenture comme une alternative sérieuse, voire supérieure dans certains cas et encourage les astronomes amateurs à surmonter les préjugés pour essayer cette méthode.
📥 04-L-argenture-des-miroirs.pdf🔍 04-L-argenture-des-miroirs.pdf
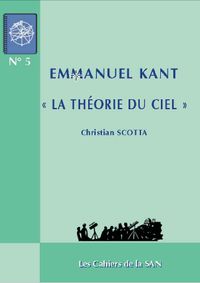
253.6 ko Thème : histoire des sciences
Dans ce livret, Christian SCOTTA analyse l’ouvrage d’Emmanuel Kant, La Théorie du Ciel (1755), dans lequel celui-ci propose une explication cosmologique rationnelle de l’univers fondée sur la gravitation newtonienne. Il cherche à répondre à deux questions restées ouvertes par Newton : d’où vient le mouvement initial des planètes, et pourquoi les étoiles ne s’effondrent-elles pas les unes sur les autres ? Kant avance que les étoiles, comme les planètes, tournent autour d’un centre commun, ce qui équilibre les forces gravitationnelles par des forces centrifuges. Il imagine que le Système solaire est né d’un immense nuage de matière (nébuleuse) en rotation. Kant anticipe ainsi la théorie nébulaire de Laplace. Plus largement, Kant élargit sa réflexion au cosmos : il imagine un univers infini, structuré en galaxies, toutes en rotation autour d’un centre universel. L’univers a une histoire : il a commencé et ne cessera jamais d’évoluer. Enfin, Kant situe l’humanité dans une position intermédiaire entre les mondes grossiers proches du Soleil et les mondes subtils lointains, peuplés d’êtres plus « parfaits ». Il propose une hiérarchie cosmique qui reflète aussi une échelle morale et spirituelle, dans la tradition des penseurs médiévaux.
📥 05-kant-La-theorie-du-ciel.pdf🔍 05-kant-La-theorie-du-ciel.pdf
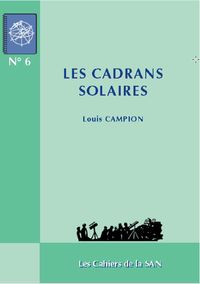
1.75 Mo Thème : instrumentation
Ce fascicule porte sur les cadrans solaires et leur construction, avec des explications sur leur fonctionnement et leur histoire. C’est un guide complet qui montre comment mieux comprendre et peut-être fabriquer son propre cadran solaire.Le cadran solaire fonctionne grâce à un gnomon dont l'ombre indique l'heure. La précision de sa construction dépend de la correction de l'orientation du style, qui doit être parallèle à l'axe de la Terre, c’est-à-dire dirigé vers le pôle céleste. La position du gnomon, particulièrement son élévation, est liée à la latitude du lieu, ce qui montre l’importance de connaître cette latitude pour réaliser un cadran précis. La direction méridienne est déterminée pour que le gnomon soit orienté selon l’axe du pole céleste, et le tracé du cadran permet d’interpréter l’ombre pour indiquer l’heure. Sont mentionné plusieurs types de cadrans, qui se distinguent par leur orientation, leur forme, et leur méthode de lecture du temps solaire selon la position du soleil.
📥 06-Les-cadrans-solaires.pdf🔍 06-Les-cadrans-solaires.pdf
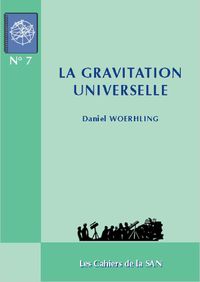
278.17 ko Thème : Histoire des sciences
Ce fascicule retrace les grandes étapes scientifiques qui ont mené de la découverte de la chute des corps par Galilée à l'élaboration de la théorie de la gravitation universelle par Newton. Il met en lumière l’émergence de la méthode expérimentale, fondement de la science moderne qui privilégie l’observation et l’expérimentation sur les spéculations abstraites. Cette méthode révolutionne la connaissance en permettant de construire les lois à partir des faits naturels. Daniel Woehrling dans ce livret, s'intéresse à l’importance du principe d’inertie, issu de l’étude du mouvement des corps en chute libre, qui constitue la base de toute la physique mécanique newtonienne. La théorie de Newton marque l’unification de la physique terrestre et céleste, donnant naissance au premier grand système scientifique du monde. Le fascicule est structuré en deux parties : la première va de Galilée au principe d’inertie, la seconde du principe d’inertie à la gravitation universelle.
📥 07-la-gravitation-universelle.pdf🔍 07-la-gravitation-universelle.pdf
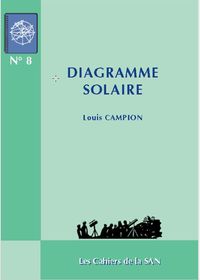
295.87 ko Thème : calculs
Ce fasicule rédigé par Louis Campion, capitaine au long cours, explore divers aspects liés aux mouvements de la Terre et du Soleil, ainsi que la mesure du temps solaire à partir des concepts de Temps solaire vrai local (Tvg) et de Temps solaire moyen local (Tmg), et des variations dues à l'orbite elliptique de la Terre et à l'inclinaison de son axe. L'équation du temps (ET) est introduit ainsi que les corrections nécessaires pour obtenir le temps universel (TU) et le temps légal (TL). La trajectoire apparente du Soleil est discutée via le calcul sa hauteur (H) et son azimut (Z) à un instant et un lieu donnés. Une section est dédiée à la construction et à l'utilisation des diagrammes solaires pour visualiser la course du Soleil dans le ciel à différentes dates. Ces diagrammes sont utiles pour évaluer l'énergie solaire reçue en fonction de la saison et de la latitude du lieu. Enfin, des tableaux de valeurs quotidiennes pour la déclinaison solaire, l'équation du temps, l'éclairement extraterrestre, la durée moyenne du jour, et l'irradiation extraterrestre reçue sur une surface horizontale sont fournis.
📥 08-diagramme-solaire.pdf🔍 08-diagramme-solaire.pdf

36.29 Mo Thème : calculs
L'objectif de Louis Campion dans ce fasicule et d'amener le lecteur à pouvoir déterminer l'endroit exact du ciel ou se trouve tel astre ou curiosité céleste. Par complémentarité le problème inverse : observant un astre dans le ciel, pouvoir déterminer où l'on se trouve est également abordé. Il aborde: des élements de géométrie et de trigonométrie sphérique, les systèmes de coordonnées, les sphères de référence, l'utilisation des éphémérides.
📥 09-Astronomie-de-position-theorie.pdf🔍 09-Astronomie-de-position-theorie.pdf
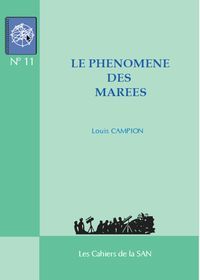
304.09 ko Thème : calculs
Ce fascicule présente le phénomène des marées qui sont des mouvements oscillatoires périodiques du niveau de la mer, causés principalement par l’attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. l’auteur retrace l'historique de la compréhension des marées, des théories antiques à celles de Newton et Laplace, et détaille les principes physiques sous-jacents aux forces génératrices de marée. Sont fourni des définitions clés, des méthodes de calcul pour les hauteurs et heures de marée et des illustrations de l’impact économique et pratique des marées sur la navigation et les activités portuaires.
📥 11-Le-phenomene-des-marees.pdf🔍 11-Le-phenomene-des-marees.pdf
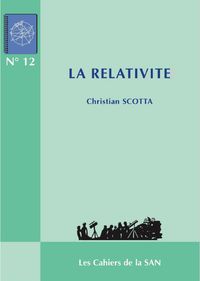
196.33 ko Thème : Astrophysique et cosmologie
Christian Scotta explore ici, sans équation, les concepts de la relativité restreinte et générale. Il aborde des sujets comme l'invariance de la vitesse de la lumière, l'équivalence entre accélération et gravitation, la courbure de l'espace-temps, et la déviation de la lumière. En relativité générale, la gravitation n’est plus une force, mais une manifestation de la courbure de l’espace-temps provoquée par la masse. Ainsi, les planètes suivent les « géodésiques » de cet espace courbe. Le temps lui-même est affecté : une horloge proche d’un objet massif tourne plus lentement. Les observations confirment cette théorie
📥 12-La-relativite.pdf🔍 12-La-relativite.pdf
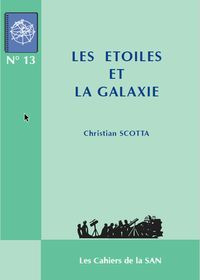
207.64 ko Thème : astrophysique et cosmologie
Dans ce fascicule, Christian Scotta, nous présente les étoiles,depuis leurs propriétés fondamentales telles que leur brillance et leur couleur, leurs distances et leur classification, jusqu'à leur cycle de vie, de la naissance par fusion nucléaire à leur destin ultime, qu'il s'agisse de naines blanches, d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. Il se penche également sur les étoiles doubles et variables avant d'analyser en profondeur notre propre Galaxie, la Voie Lactée, en détaillant sa structure, la répartition de ses étoiles en amas, les populations stellaires, ainsi que sa dynamique de rotation et sa masse.
📥 13-Les-etoiles-et-la-galaxie.pdf🔍 13-Les-etoiles-et-la-galaxie.pdf
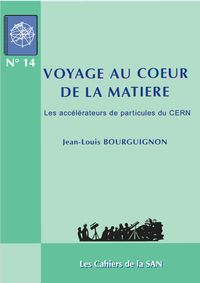
629.13 ko Thème : astrophysique et cosmologie
Cet exposé est essentiellement un compte-rendu d'une visite au CERN en 1993, expliquant la recherche fondamentale qui y est menée, en particulier la création de matière à partir d'énergie à l'aide d'accélérateurs de particules et de collisionneurs. Jean-Louis Bourgignon détaille le fonctionnement et les équipements du CERN, ainsi que les détecteurs utilisés pour analyser les collisions. Puis, il aborde les résultats des découvertes, comme en 1983, les bosons W et Z, porteurs de l’interaction faible. et les découvertes confirmant le modèle standard des particules, basé sur les quarks et les leptons. Les accélérateurs recréent les conditions de l’Univers quelques fractions de seconde après le Big Bang. Ainsi, l’astrophysique rejoint la physique des particules pour explorer les origines du cosmos.
📥 14-Voyage-au-coeur-de-la-matiere.pdf🔍 14-Voyage-au-coeur-de-la-matiere.pdf
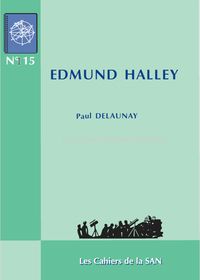
3.85 Mo Thème : histoire des sciences
Né en 1656 près de Londres, Edmund Halley est marqué dès l’enfance par les comètes. À 20 ans, il part observer le ciel austral à Sainte-Hélène et y cartographie des étoiles inconnues. Il publie ses travaux à son retour, entre à la Royal Society et devient un astronome respecté. En 1682, il observe une comète qui portera plus tard son nom. Il collabore étroitement avec Newton et l'encourage à publier ses Principia et en finance même l'impression. Halley comprend que les comètes peuvent revenir périodiquement, et prédit avec succès celle de 1758–1759 : la célèbre comète de Halley. Scientifique aux multiples talents, il mesure la distance Terre-Soleil grâce aux transits de Vénus, invente une cloche de plongée, propose d’estimer l’âge de la Terre avec la salinité des océans et élabore la première carte des variations du champ magnétique terrestre. Astronome Royal à la fin de sa vie, il démontre que les étoiles dites «fixes» se déplacent et défend l’idée d’un univers infini. Il meurt en 1742, à 85 ans, après une vie consacrée à la Science, marquée par l'audace, la rigueur et la curiosité.
📥 15-Edmund-Halley.pdf🔍 15-Edmund-Halley.pdf

243.21 ko Thème : Histoire des sciences
Le système de Ptolémée, élaboré à partir des travaux d’Hipparque, a dominé la pensée astronomique pendant près de 17 siècles. Bien que l’héliocentrisme ait été proposé par Aristarque dès le IIIème siècle av. J.-C., la vision géocentrique d’Aristote — avec la Terre immobile au centre de l’Univers — a prévalu, notamment à cause de son adéquation apparente aux observations. Hipparque introduisit des notions précises comme la trigonométrie, la précession des équinoxes et un catalogue d’étoiles. Ptolémée, reprenant ces travaux, formalisa le système dans L’Almageste, fondé sur des épicycles, déférents et excentriques pour rendre compte des mouvements complexes des planètes. Ce système, bien que faux, était suffisamment efficace pour prédire les positions des astres. Il persista malgré ses limites, jusqu'à ce que Copernic propose une vision héliocentrique, confirmée par les observations de Galilée à l’aide de la lunette astronomique. Les travaux de Kepler (lois des orbites) et de Newton (loi de la gravitation) vinrent définitivement asseoir le modèle moderne. Le système de Ptolémée reste un témoignage remarquable d’ingéniosité fondée sur les connaissances de l’époque.
📥 16-Le-systeme-de-Ptolemee.pdf🔍 16-Le-systeme-de-Ptolemee.pdf

5.68 Mo Thème : histoire des sciences
Ce fascicule retrace l’évolution de la navigation depuis les temps préhistoriques jusqu’au XIXème siècle. Les premiers hommes naviguaient à vue, en longeant les côtes avec des embarcations rudimentaires. Progressivement, l’observation des astres, notamment l’étoile polaire, leur permit de s’orienter et de naviguer plus loin. Les civilisations antiques, comme les Égyptiens et les Grecs, utilisèrent les étoiles pour se repérer, avant d’inventer des instruments comme le kamal, l’astrolabe ou l’arbalestrille. L’introduction de la boussole fut une révolution, surtout pour les navigateurs du Nord. La latitude devint facile à déterminer grâce à l’observation du Soleil ou des étoiles, mais la longitude resta un problème majeur jusqu’à l’invention des chronomètres précis au XIXème siècle. C’est à cette période que Marc de Saint Hilaire publia une méthode, aujourd’hui universellement adoptée comme théorie du point astronomique, à partir de la ‘droite de hauteur’ découverte par le capitaine américain Sumner.
📥 17-histoire-de-la-navigation.pdf🔍 17-histoire-de-la-navigation.pdf

810.66 ko Thème : astrophysique
Ce fascicule expose les bases de la théorie de la relativité d’échelle, développée par Laurent Nottale, au milieu des années 90, qui remet en question l’hypothèse classique de la différentiabilité de l’espace-temps. Inspirée des fractales de Mandelbrot, cette théorie suppose que l’espace-temps présente des structures à toutes les échelles et que les lois physiques doivent rester valables quelle que soit l’échelle considérée. Elle permet d’unifier les lois classiques et quantiques à travers une « dérivée covariante d’échelle », et montre que le comportement quantique serait une manifestation du caractère fractal de l’espacetemps. À grande échelle, le chaos dynamique rend les trajectoires imprévisibles, ce qui impose une description probabiliste, quasi-quantique. Cette approche est ensuite appliquée à la formation des systèmes planétaires : les orbites suivent des lois quantifiées, analogues à celles de l’atome d’hydrogène, avec une constante fondamentale de vitesse (w ≈ 144 km/s). D'après l'auteur, le modèle semble expliquer les distances des planètes du système solaire, des exoplanètes et même des paires de galaxies, avec une précision remarquable.
🔍 19-Relativite-d-echelle.pdf

266.73 ko Thème : histoire des sciences
Ce texte retrace l’évolution des conceptions de l’Univers, de l’Antiquité à la cosmologie moderne. Il évoque les visions de Ptolémée, Copernic, Kepler, Newton, Leibniz, Kant, et leurs divergences sur la nature, l'étendue et l’origine de l’Univers. Newton imagine un espace-temps absolu, tandis que Leibniz et Kant privilégient un Univers dynamique et structuré. Le paradoxe de la nuit noire questionne l’infinité de l’Univers. Einstein introduit la relativité : l’espace-temps est courbe, influencé par la matière. Hubble découvre la fuite des galaxies, posant les bases d’un Univers en expansion. Lemaître puis Gamow développent le modèle du Big Bang, confirmé par le rayonnement fossile découvert en 1965. La densité de l’Univers détermine son destin : expansion infinie ou effondrement. Le théorème de Birkhoff et le concept de temps cosmique permettent de décrire l’Univers global à partir d’observations locales. Le principe anthropique suggère que l’Univers est tel qu’il permet l’émergence de la vie consciente. Enfin, le texte interroge les limites de la cosmologie, entre observation, extrapolation et interprétation.
📥 20-Introduction-a-la-cosmologie.pdf🔍 20-Introduction-a-la-cosmologie.pdf

201.08 ko Thème : astrophysique et cosmologie
Ce fascicule est un résumé de la conférence de Paul Couteau, à l'époque astronome à l'observatoire de Nice, donnée le 25 janvier 1991 au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Il présente les quatre forces fondamentales de la nature : la gravitation, l’électromagnétisme, l’interaction forte et l’interaction faible. Ces forces dériveraient d’une force unique, aujourd’hui disparue, qui aurait existé juste après le Big Bang. La gravitation est une déformation de l’espace due à la masse ; elle est décrite par les équations différentielles. L’électromagnétisme, véhiculé par les photons, agit sur les particules chargées comme les électrons. L’interaction forte, ou force de couleur, lie les quarks à l’intérieur des noyaux atomiques grâce aux gluons. L’interaction faible, transmise par le boson Z⁰, permet des désintégrations comme celle de l’électron en neutrino. Ces forces sont transmises par des particules appelées médiatrices ou bosons. La physique quantique révèle la réalité nous échappe : nous ne pouvons que l’approcher sans jamais la saisir complètement. Le texte conclut sur la quête de la force primordiale, véritable « pierre philosophale » des physiciens, qui unifierait l’ensemble des interactions connues
📥 21-Les-4-forces-fondamentales-de-la-nature.pdf🔍 21-Les-4-forces-fondamentales-de-la-nature.pdf

4.43 Mo Thème : observation
Ce fascicule explique les effets optiques dus à l’atmosphère terrestre sur les observations astronomiques. L’atmosphère, composée principalement d’azote et d’oxygène, dévie, absorbe et diffuse la lumière des astres. La réfraction astronomique fait paraître les astres plus hauts qu’ils ne le sont réellement. Elle résulte de la variation progressive de la densité de l’air avec l’altitude. Cette réfraction nécessite des corrections dans les mesures des hauteurs d’astres, tout comme la réfraction terrestre, la parallaxe, et la dépression de l’horizon. D'autres phénomènes liés à l’atmosphère sont abordés : scintillation des étoiles, variation de la couleur du Soleil aux levers et couchers, mirages, aurores polaires, éclipses de Lune (rougeoiement dû à la réfraction), rayon vert, halos et arcs-en-ciel. Louis Campion insiste sur la complexité des corrections à appliquer et sur l’imprécision induite par les variations locales de l’atmosphère. Ces phénomènes, tout en perturbant l’observation astronomique, offrent aussi des spectacles naturels fascinants.
📥 22-La-refraction-astronomique.pdf🔍 22-La-refraction-astronomique.pdf

2.78 Mo Thème : histoire des sciences
Dans ce fascicule, Louis Campion explore le système de Kepler, en expliquant comment celui-ci, s'appuyant sur les observations de Tycho Brahe, a établi ses lois du mouvement planétaire. Il détaille la méthode de triangulation utilisée par Kepler pour déterminer les orbites terrestres et martiennes, aboutissant à la découverte des orbites elliptiques et des trois lois fondamentales. Il examine également comment le système héliocentrique de Kepler explique les mouvements apparents et les phases des planètes, comparant ces phénomènes aux phases lunaires et discutant l'importance des transits de Vénus pour mesurer la distance Terre-Soleil.
📥 24-Le-systeme-de-Kepler.pdf🔍 24-Le-systeme-de-Kepler.pdf
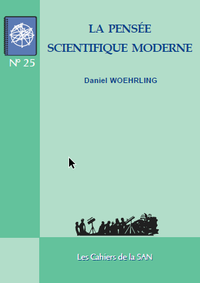
355.89 ko Thème : philosophie
La pensée scientifique moderne vise à comprendre le réel par une méthode fondée sur l’observation, l’expérimentation et la modélisation. Contrairement à l’intuition spontanée, souvent trompeuse, la science repose sur des définitions opératoires et des relations reproductibles, assurant l’objectivité. Les phénomènes sont décrits par des paramètres mesurables, aboutissant à des lois naturelles exprimées mathématiquement. Ces lois peuvent être intégrées dans des théories générales par un travail de synthèse. Le réductionnisme permet de relier les sciences entre elles, en ramenant des phénomènes complexes à des mécanismes plus fondamentaux. Le déterminisme scientifique affirme que tout phénomène a une cause explicable par des lois, même si la physique moderne en limite la connaissance parfaite (principe d’incertitude). La science, en dépassant les limites de l’intuition, libère la pensée de l’irrationnel et du mysticisme. Elle ne propose pas une vérité absolue, mais une vérité perfectible, toujours ouverte à révision. L’esprit scientifique est formel, rationnel et universel, en quête de cohérence et de compréhension globale du monde.
📥 25-La-pensee-scientifique-moderne.pdf🔍 25-La-pensee-scientifique-moderne.pdf
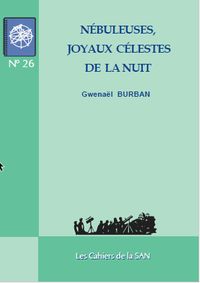
1.34 Mo Thème : observations
Gwenaël Burban explore les nébuleuses, objets fascinants du ciel nocturne. Il introduitd'abord la spectrométrie, outil essentiel pour comprendre les couleurs et la composition des nébuleuses à travers les raies d’absorption et d’émission. Les nébuleuses diffuses,dites régions H II, sont des nuages d'hydrogène excité par de jeunes étoiles émettant une lumière rouge caractéristique. Les régions H I, elles, contiennent de l’hydrogène non excité, détecté grâce à une émission radio de 21 cm. Les nuages de poussières interstellaires, composés de particules solides, diffusent la lumière et provoquent des effets optiques comme le rougissement. Les nébuleuses planétaires résultent de l’expulsion de gaz par des étoiles en fin de vie. Les supernovae, explosions d’étoiles massives, enrichissent l’espace de nouveaux éléments et produisent des objets compacts comme pulsars ou trous noirs. Elles sont à l’origine de nuages moléculaires riches en composés organiques. Enfin, les rayons cosmiques, particules à haute énergie issues de ces phénomènes, révèlent les zones denses de la Galaxie.
📥 26-Nebuleuses-Joyaux-celestes-de-la-nuit.pdf🔍 26-Nebuleuses-Joyaux-celestes-de-la-nuit.pdf

265.38 ko Thème : histoire des sciences
Christian Scotta explore les propriétés physiques et les théories sur la nature de la lumière avec une approche historique. Il commence par les lois de l’optique géométrique : la lumière se propage en ligne droite, produisant ombre et pénombre, et subit réflexion et réfraction. Newton découvre la dispersion de la lumière blanche en spectre coloré via un prisme. Deux grandes théories s’opposent au XVIIe siècle : la théorie corpusculaire de Newton (lumière = particules) et la théorie ondulatoire de Huygens (lumière = ondes). La réfraction est expliquée différemment dans chaque théorie, mais l'idée de l'éther (milieu de propagation des ondes lumineuses) soulève des contradictions. L’onde lumineuse présente diffraction et interférences, ce que la théorie corpusculaire n'explique pas. Au XXe siècle, l’effet photoélectrique met en évidence le caractère corpusculaire de la lumière (photons). Einstein et la mécanique quantique réconcilient les deux approches : la lumière a une dualité onde-corpuscule. Elle se comporte tantôt comme une onde (diffraction), tantôt comme une particule (photoélectricité), imposant une nouvelle vision de la matière et de l’énergie.
📥 27-La-lumiere.pdf🔍 27-La-lumiere.pdf
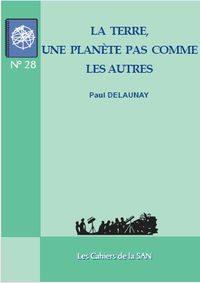
6.66 Mo Thème : planétologie
La Terre est une planète unique par sa position dans le Système solaire et les conditions qui y ont permis l’apparition de la vie. Située à une distance idéale du Soleil, elle a su retenir une atmosphère protectrice et a connu une évolution géologique et biologique riche. Née il y a 4,6 milliards d’années dans une nébuleuse, la Terre a subi des bombardements, un intense volcanisme, et la formation de son atmosphère et de ses océans. La vie y est apparue dans l’eau, puis a évolué vers des formes terrestres. Son noyau métallique génère un champ magnétique protecteur. L’axe incliné de la Terre, ses mouvements de rotation et de révolution expliquent les saisons, les jours et les années. La tectonique des plaques façonne les continents. L’atmosphère engendre des phénomènes comme la réfraction, les aurores polaires et l’absorption de certaines ondes. Enfin, la Terre est surveillée depuis l’espace et menacée par les activités humaines : déforestation, pollution, nucléaire… Paul Delaunay appelle à une conscience écologique face à ces dangers.
📥 28-La-Terre-une-planete-pas-comme-les-autres.pdf🔍 28-La-Terre-une-planete-pas-comme-les-autres.pdf

415.71 ko Thème : histoire des sciences
Dans ce fascicule, Christian SCOTTA retrace la vie et l’oeuvre scientifique d’Isaac Newton, figure majeure de la science moderne. Né en 1642, il étudie à Cambridge où il développe une pensée originale dans plusieurs domaines. Newton découvre la loi de la gravitation universelle, formulée dans ses Principia Mathematica, où il unifie la physique céleste et terrestre. Il met aussi en évidence les lois du mouvement et invente le calcul infinitésimal, en parallèle à Leibniz. En optique, il démontre que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs, grâce à la dispersion par un prisme. Il conçoit un télescope à miroir pour éviter l’aberration chromatique. Newton croit en une mécanique fondée sur des lois universelles, mais aussi en un ordre divin. Il s’intéresse à l’alchimie et aux textes bibliques, ce qui nuance son image de pur rationaliste. Il meurt en 1727, laissant une oeuvre fondatrice. Ses idées influenceront durablement la science, jusqu’à ce que la relativité et la physique quantique en redéfinissent certaines limites.
📥 29-Isaac-Newton.pdf🔍 29-Isaac-Newton.pdf

5.11 Mo Thème : observation
Dans ce fascicule, Paul DELAUNAY présente sous une forme didactique à destination des débutants en astronomie, la Lune sous toutes ses facettes. Il retrace d’abord la place de notre satellite dans le système solaire, sa formation, ses caractéristiques physiques (taille, gravité, albédo) et ses reliefs marquants, mers et cratères. La Lune est un satellite unique par sa taille et son influence sur la Terre, notamment pour les marées. Ce texte détaille les mouvements de la Lune (révolution, rotation, librations), ses phases et les divers types d’éclipses. Il aborde aussi les phénomènes visuels comme la lumière cendrée, les halos lunaires ou les occultations. L’auteur traite de la conquête spatiale (missions Apollo), et des nombreuses expériences scientifiques qui y furent menées. Enfin, le texte revient sur des croyances populaires erronées (comme la « Lune rousse » ou la « grosse Lune à l’horizon ») et évoque l'influence lunaire sur le calendrier, notamment pour fixer la date de Pâques.
📥 30-la-Lune-reine-de-la-nuit.pdf🔍 30-la-Lune-reine-de-la-nuit.pdf
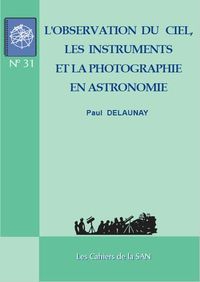
6.71 Mo Thème : observation
Ce fascicule s’adresse aux personnes qui souhaitent découvrir la pratique de l’astronomie en amateur. Paul Delaunay présente les bases de l’observation du ciel nocturne, les instruments nécessaires (jumelles, lunettes, télescopes) et la photographie astronomique. Il explique les unités de mesure des distances astronomiques (annéelumière, parsec), les magnitudes (éclat apparent et absolu des étoiles) et l’organisation du ciel en constellations. Il aborde ensuite l’observation à l’oeil nu et avec des jumelles, en expliquant comment choisir un modèle adapté. Il détaille les types de télescopes (Newton, Cassegrain, Schmidt, Schmidt-Cassegrain), leurs principes optiques et leurs spécificités. La photographie astronomique est abordée : techniques de pose, effets de la rotation terrestre, mise en station, suivi, choix des pellicules et usage des CCD. L’auteur conclut en soulignant l’importance de la pratique et de la patience pour progresser. Si depuis la rédaction de ce fascicule la photographie argentique a disparue et que désormais le numérique domine, les fondamentaux restent pertinents.
📥 31-L-observation-du-ciel.pdf🔍 31-L-observation-du-ciel.pdf
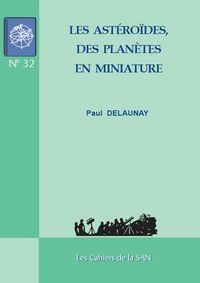
5.24 Mo Thème : observation
Les astéroïdes sont de petits corps célestes gravitant autour du Soleil, principalement situés dans la Ceinture principale entre Mars et Jupiter. Leur découverte a débuté en 1801 avec Cérès, à la suite des recherches fondées sur la loi empirique de Titius- Bode, qui suggérait l'existence d'une planète entre Mars et Jupiter. Cette région est en réalité peuplée de milliers d’astéroïdes dont la formation a été empêchée par l’influence gravitationnelle de Jupiter. Certaines zones de la Ceinture sont désertées à cause des lacunes de Kirkwood, liées à des résonances gravitationnelles. D’autres, au contraire, comme les zones des Troyens de Jupiter, sont stables. Des astéroïdes dits hors-ceinture, tels que les Amor, Apollo et Aten, croisent parfois l’orbite terrestre, représentant un risque de collision. Leur taille varie de quelques mètres à plus de 1000 km, et leur forme est souvent irrégulière. Certains possèdent des satellites. Leur composition (rocheuse, métallique, mixte) permet une classification en différents types selon l’albédo. L’observation visuelle des astéroïdes est difficile mais possible avec un équipement adapté et une bonne préparation. Il est également possible de les photographier. Si le film argentique type TP 2415 mentionné n’est plus utilisé de nos jours, les principes de la détection restent valides.
📥 32-Les-asteroides.pdf🔍 32-Les-asteroides.pdf
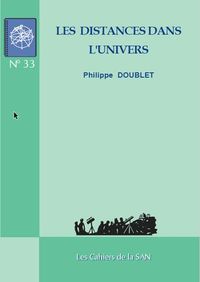
593.9 ko Thème : astrophysique
Ce fascicule de Philippe Doublet retrace l’histoire et les méthodes de mesure des distances dans l’Univers, des plus proches étoiles jusqu’aux galaxies les plus lointaines. Il commence par les méthodes directes, comme la parallaxe trigonométrique, utilisée pour mesurer les étoiles proches, et introduit la notion de parsec. Il détaille ensuite les parallaxes dynamiques, convergentes et statistiques, notamment dans l’étude des amas stellaires. Le diagramme HR est présenté comme un outil fondamental pour relier luminosité et température des étoiles. Les indicateurs primaires comme les RR Lyrae, céphéides et novae permettent de mesurer la distance de galaxies proches. Les indicateurs secondaires incluent l’étude des amas globulaires, des supernovae et des régions HII pour des galaxies plus lointaines. Enfin, les indicateurs tertiaires permettent d’explorer l’Univers profond via l’interférométrie, les galaxies brillantes d’amas et la loi de Hubble. Le texte conclut sur l’importance de perfectionner ces méthodes pour affiner la constante d’expansion de l’Univers.
📥 33-Les-distances-dans-l-Univers.pdf🔍 33-Les-distances-dans-l-Univers.pdf

562.7 ko Thème : histoire des sciences
Daniel Woerhling propose dans ce fascicule un aperçu de l'évolution de la compréhension humaine des étoiles. Il explore l'histoire de l'astronomie, depuis les premières observations des constellations jusqu'au développement de la spectroscopie et de l'astrophysique. Il détaille comment les étoiles, initialement cartographiées comme de simples points lumineux, sont devenues des clés pour percer les secrets de la matière et de l'Univers, abordant des concepts tels que la fusion nucléaire, les naines blanches, les supernovae, les pulsars les trous noirs et le Big Bang, et insistant sur l'importance cruciale de l'observation scientifique dans ces découvertes.
📥 34-L-homme-face-aux-etoiles.pdf🔍 34-L-homme-face-aux-etoiles.pdf
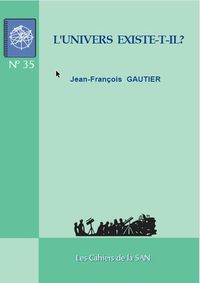
202.94 ko Thème : philosophie
Jean-François GAUTIER s’interroge ici sur la nature même de l’Univers : est-il un objet que l’on peut véritablement observer, ou seulement un concept forgé par l’esprit ? L’auteur distingue trois formes d’astronomie : la cosmographie (repérage des objets célestes), la cosmologie (étude des lois qui régissent l’Univers), et la cosmogonie (origine de l’Univers). Il montre que l’Univers, s’il est pris comme un Tout, échappe à l’observation directe et à toute relation, car il n’a pas d’« extérieur » mesurable. En science, on ne peut qu’observer des parties locales de l’Univers et en induire des représentations globales. Ces représentations reposent sur des modèles mathématiques, qui ne décrivent pas l’Univers en soi, mais servent d’outils pour relier des données. Ainsi, l’Univers n’est pas un objet observable ou expérimental, mais une construction intellectuelle. Les théories du big bang, les notions de temps et d’espace cosmique sont des conventions utiles, non des vérités absolues. L’auteur appelle à la prudence face aux illusions d’une « science du Tout ». Voir aussi le n°20 des fascicules dans lequel Christian Scotta répond à certaines propositions de Jean-François Gautier.
📥 35-L-Univers-existe-t-il.pdf🔍 35-L-Univers-existe-t-il.pdf

203.32 ko Thème : histoire des sciences
Ce fascicule propose une revue de l’évolution des représentations humaines de la voûte céleste, de la Préhistoire à nos jours. Si les premières oeuvres préhistoriques ne montrent que peu de scènes célestes, les premières évocations du ciel apparaissent dès l’Antiquité, avec les Sumériens, Égyptiens, Chinois, et Mayas. Ces civilisations associaient souvent le ciel à des symboles comme l’arbre, la montagne ou la tortue, servant de lien entre Terre et Cosmos. Les constellations, les zodiaques, et la Voie lactée étaient intégrés dans des récits mythologiques ou religieux. De nombreuses architectures, comme les ziggurats, les pyramides ou les temples, sont orientées selon les astres. Le texte évoque aussi les superstitions liées aux comètes et leur interprétation progressive comme objets célestes réguliers. À partir de Copernic, Galilée et Tycho Brahé, la vision scientifique de la voûte céleste remplace les conceptions géocentriques anciennes. La symbolique cosmique se retrouve dans l’art religieux, les cathédrales, et jusque dans la poésie populaire. Fascicule publié pour l'instant sans les illustrations
📥 36-Representation-de-la-voute-celeste.pdf🔍 36-Representation-de-la-voute-celeste.pdf
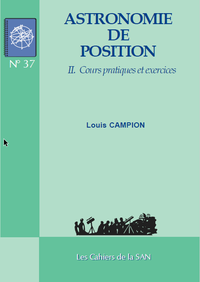
31.49 Mo Thème : calculs
Ce fascicule est un cours de calculs astronomiques de Louis Campion sous forme de 18 leçons qui abordent par exemple; les heures des lever et coucher d'un astre, l'utilisation des éphémérides astronomiques, identification des satellites de Jupiter, l'équation du temps, la détermination de la date de Pâques,.... Les calculs présentés l’ont été pour la période 1991-1993 et n’ont pas été réactualisés depuis. Pour les mettre à jour, il faut se reporter aux Ephémérides astronomiques actuels.
📥 37-astronomie-de-position-II.pdf🔍 37-astronomie-de-position-II.pdf

3.49 Mo Thème : divertissement
Ce fascicule propose une revue du vocabulaire utilisé en astronomie au travers d’une activité ludique de cruciverbiste et 14 grilles ! Les thèmes sont divers tels que « Les neuf planètes », « 15 célébrités astronomiques », « 13 nébuleuses », « 12 piétons lunaires », « 14 Alpha », « 15 Bêta », « 16 Gamma », « 16 Delta », « 16 Dzeta », « 11 Eta », « 14 Lambda, Omicron, Mu, Théta », « 21 constellations boréales », «19 lanceurs », « 34 vaisseaux spatiaux », « 19 découvreurs de sept comètes ou plus», « 36 découvreurs de comètes ou moins », « 15 astéroïdes », «16 satellites de Jupiter », « 15 satellites de Saturne », « 15 satellites d’Uranus », «24 étoiles », «41 découvreurs d’étoiles doubles », « 13 mers et océans lunaires », et bien sûr les solutions !
📥 38-En-croisant-les-mots-astronomiquement.pdf🔍 38-En-croisant-les-mots-astronomiquement.pdf

857.72 ko Thème : histoire des sciences
Ce fascicule aborde le phénomène de la précession des équinoxes, un lent déplacement des points équinoxiaux causé par l’inclinaison de l’axe terrestre et les forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune. Hipparque en fit la découverte au IIème siècle av. J.-C. en constatant des variations dans les longitudes célestes. L’axe terrestre décrit un cône de 47° en 25 790 ans, entraînant un déplacement des constellations du zodiaque observées aux équinoxes. La nutation, découverte plus tard, est une oscillation secondaire de cet axe. Le texte décrit également les instruments d’observation historiques comme la lunette méridienne, le cercle mural et le gyroscope, inventé par Foucault pour démontrer la rotation terrestre. Le gyroscope et la toupie illustrent le principe physique à l’origine de la précession. Ce phénomène permet de reconstituer les ciels anciens et d’éclairer certains alignements de monuments historiques. La précession affectera même l’étoile polaire au fil des millénaires.
📥 39-La-precession-des-equinoxes.pdf🔍 39-La-precession-des-equinoxes.pdf
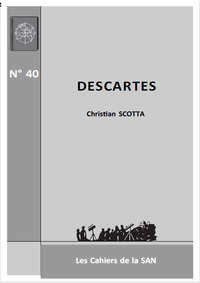
588.54 ko Thème : histoire des sciences
Dans ce fascicule, Christian Scotta aborde les contributions de René Descartes à la physique et à l'astronomie, délaissant ses travaux sur la nature humaine. Il explore sa philosophie première (métaphysique), ses règles de la connaissance et sa philosophie seconde (physique), en particulier ses théories sur le système du monde, les tourbillons, la pesanteur et la lumière. Il compare les idées de Descartes à celles de Newton, soulignant leurs similitudes et divergences, notamment sur le rôle de Dieu et des lois de la physique. Malgré des conceptions en physique en grande partie fausses, les idées philosophiques de Descartes ont eu une influence durable.
📥 40-Descartes.pdf🔍 40-Descartes.pdf

741.02 ko Thème : histoire des sciences
Le Polonais Nicolas Copernic (1473-1543) accomplit la première grande réforme de l’astronomie en faisant tourner la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Copernic reste fidèle aux Anciens : les planètes décrivent des cercles parfaits autour du Soleil, et ces cercles se combinent pour expliquer les irrégularités de leurs mouvements. Les étoiles sont à une distance immense mais finie, et constituent une sphère qui délimite le monde visible. Même délogée du centre du monde, l’humanité reste proche du milieu du monde et conserve ainsi une place privilégiée dans l’Univers. Mais Copernic abolit la dichotomie entre le monde sublunaire et le monde supra lunaire. Il répond aux objections contre les mouvements de la Terre au moyen de la relativité du mouvement local et en faisant coexister le mouvement rectiligne et le mouvement circulaire dans un même corps.
Copernic est un homme de la Renaissance chez lequel se côtoient plusieurs facettes. Il est à la fois chanoine, médecin, astronome et peintre à ses loisirs. Il admire les Anciens (et plus particulièrement l’astronome grec Ptolémée). Il porte un regard mystique sur le monde, dans lequel le Soleil est le reflet de la divinité ; le monde, harmonieux, témoigne de la perfection divine.
🔍 41-Nicolas_Copernic.pdf
Fascicules en format epub :
 41-Nicolas_Copernic.epub (2.25 Mo - 11/11/2025 11:32) téléchargé 10 fois dernier téléchargement le 06/01/2026 17:36
41-Nicolas_Copernic.epub (2.25 Mo - 11/11/2025 11:32) téléchargé 10 fois dernier téléchargement le 06/01/2026 17:36
Fascicules en format A5 imprimables :
Compléments réservés aux adhérents (se connecter)